Rencontre avec le pédagogue Hartmut von Hentig
Ancien élève du lycée français de Berlin
Le professeur von Hentig a été élève au Lycée Français de Berlin, il y a de nombreuses années. C'était à l'époque du national-socialisme (1933-1945). Il y est retourné, cette fois pour parler avec nous. Nous avons voulu savoir comment c'était pour les Français et les Juifs au Lycée Français pendant toutes ces années.

Les classes au Lycée Français
Vous étiez quand au Lycée Français ?
Je suis arrivé au Lycée Français en novembre 1937, je venais d'avoir 12 ans et je suis entré en cinquième.
Vous parliez déjà français à l'époque ?
Oui. On commençait en première année. Ensuite, tous les cours sauf ceux de sciences naturelles étaient dispensés en français – exactement comme pour vous aujourd'hui.
Vous étiez combien dans votre classe ?
Nous étions une trentaine. Les petites classes comptaient vraiment beaucoup d'élèves et leur nombre diminuait à mesure qu'on avançait en âge. A vrai dire, ça devrait être le contraire. Les grands devraient savoir comment travailler ensemble, avec beaucoup d'élèves.
Il y avait aussi des filles ?
Quand je suis arrivé, il y avait trois ou quatre filles pour 26 garçons en cinquième.
Les pauvres !
Au contraire! Tout ce qui est rare devient automatiquement précieux. Quand César a voulu diminuer le pouvoir du Sénat romain, il a augmenté le nombre de sénateurs qui sont passés de 300 à 3000. Chacun perdait de son importance. Les rares filles de notre classe étaient respectées à l'époque, et même courtisées par la suite.
La guerre à l'école
En cours, vous parliez de la guerre ?
Pas en cours. En cours, on ne parlait pas de l'actualité. Les guerres du passé étaient traitées en détail, et quand il s'agissait de savoir si la Première Guerre mondiale avait été provoquée par la Russie ou par l'Allemagne, ou si son issue avait été une bonne chose, alors on faisait référence à la Seconde Guerre mondiale. Que l'Allemagne n'ait pas été „complètement innocente“, c'était quelque chose qu'on apprenait au Lycée Français.
Vous en parliez entre élèves ?
Seulement entre amis. Je crois qu'il faut que je décrive les circonstances plus en détail : pendant la guerre, cinq ou six élèves des grandes classes devaient passer la nuit à l'école pour monter la garde. Si une bombe incendiaire tombait sur le toit, on pouvait la plupart du temps encore l'éteindre. On nous donnait pour ça deux marks par nuit, et c'était à qui aurait la place. Nous jouions à la belotte jusque tard dans la nuit et nous faisions nos rondes de contrôle pendant les alertes. Nous parlions naturellement de la guerre en de telles occasions – de quelle tournure elle prendrait et de si nous allions encore être appelés pour faire la guerre.
Il y avait des professeurs français au Lycée ?
Oui. Juste après la défaite de la France, on a vu arriver des professeurs français dans notre école. Je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient volontaires. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas demander sans nous ou plutôt, sans leur causer des problèmes.
Est-ce que le salut hitlérien était obligatoire ?
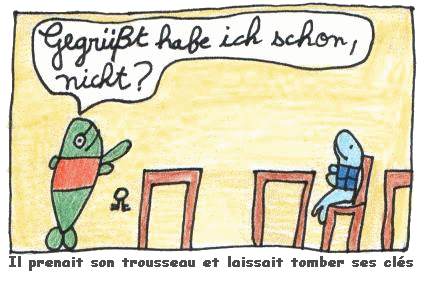
Il l'est devenu à partir d'un certain moment. Les heures de cours commençaient par « Heil Hitler ». Lindenborn, notre prof principal, était chrétien, et profondément antinazi – donc il enfreignait cette règle. Il arrivait dans la classe avec son trousseau de clés à la main, étendait le bras au-dessus de son pupitre, laissait tomber les clés – comme ça. Et puis, il disait : « J'ai déjà salué, non ? ». Il entendait par là avoir fait le salut hitlérien. Puis il ajoutait : « Quel temps abominable aujourd'hui. Eh bien maintenant, je vous souhaite une très bonne journée. »
Il y avait aussi des Juifs dans votre classe ?
Oui, il y en avait beaucoup jusqu'en 1938. J'ai ici une photo de notre classe en 1935, avec la liste des noms. Vous pouvez compter combien il y en avait.
Huit Juifs et un « demi-juif ».
Je ne les ai pas tous connus. A l'époque où je suis arrivé, en 1937, un certain nombre étaient partis entre-temps à l'étranger. Je continue à voir deux d'entre eux régulièrement – Max Petschek et Victor Schneider.
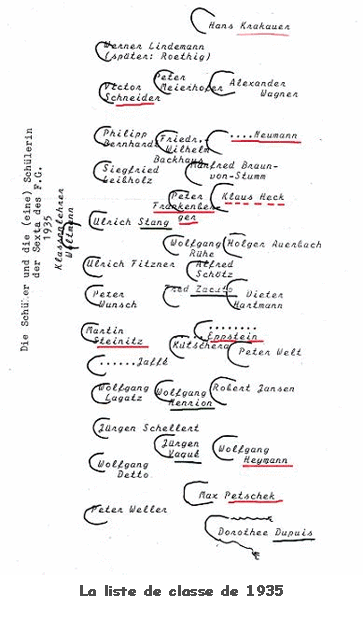
Il y avait encore des élèves juifs après 1938 ?
Non. Victor Schneider a été le dernier à partir. Il restait seulement Klaus Heck, un « demi-juif », comme disaient les nazis. Il y avait bien une raison pour que tant de Juifs fréquentent le Lycée Français, et qu'il y ait aussi tant d'étrangers ; dans ma classe il y avait les fils des ambassadeurs de Norvège et d'Irak. A l'époque, la langue des diplomates était le français et ils envoyaient leurs enfants ici : c'était donc une protection idéale pour l'école. Parce que devant les étrangers, et surtout devant les diplomates, les nazis ne voulaient pas se ridiculiser et montrer qu'ils étaient des barbares.
C'était comment d'aller à l'école pendant la guerre ?
Vous allez rire : c'était bien ! C'était mieux que la vie « à l'extérieur » qui signifiait les files d'attente, les bombardements nocturnes, les abris anti-bombardement avec leurs odeurs de renfermé, les défilés dans les rues de la jeunesse hitlérienne qui chantait à tue-tête et, ainsi de suite. A 17 ans, c'était le service du travail obligatoire, et à 18 ans, on devenait soldat. Seuls les plus jeunes, les filles et les « demi-juif » restaient – nous étions les survivants pour ainsi dire. Et à l'école, on se sentait bien et à l'abri. Loin des bruits dérangeants qu'il y avait en permanence, des tirades et discours haineux qui venait des hauts-parleurs des places publiques.
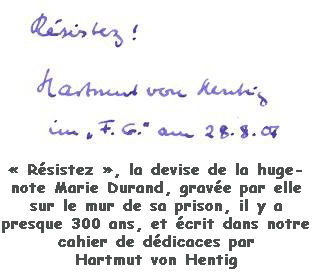
Est-ce que certains de vos camarades sont morts pendant les combats ?
Oui. C'est d'abord arrivé dans les classes au-dessus de nous. Le premier s'appelait Volker Niemeyer. Sa mort m'a particulièrement touché. Nous, les plus jeunes, nous étions dans le club nautique du lycée avec les plus grands. Les plus jeunes, les poids plume, étaient au gouvernail et les plus grands ramaient. C'est là que Volker Niemeyer est devenu mon ami. Il est tombé dans les tous premiers jours de la guerre.
D'autres articles et interviews sur le lycée Français :
Interview avec l'ancien directeur Monsieur Frank sur l'histoire du Lycée Français de Berlin pendant la Première Guerre mondiale >>
Petite histoire du Lycée Français de Berlin >>
Interview : Alina, Anastasia, David et Sidney
Dessin : David
Texte, dessin et photos © Grand méchant loup | Böser Wolf
Dessin : David
Texte, dessin et photos © Grand méchant loup | Böser Wolf

